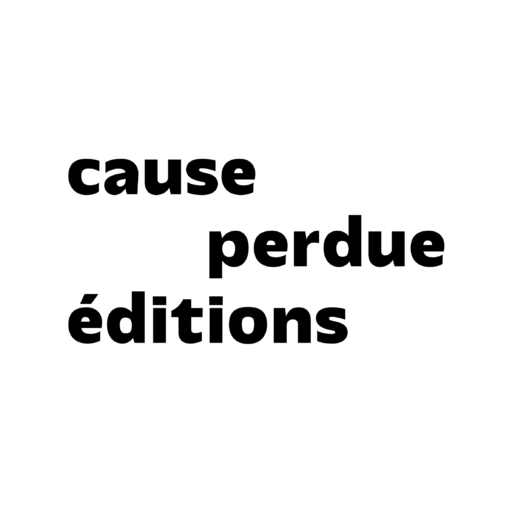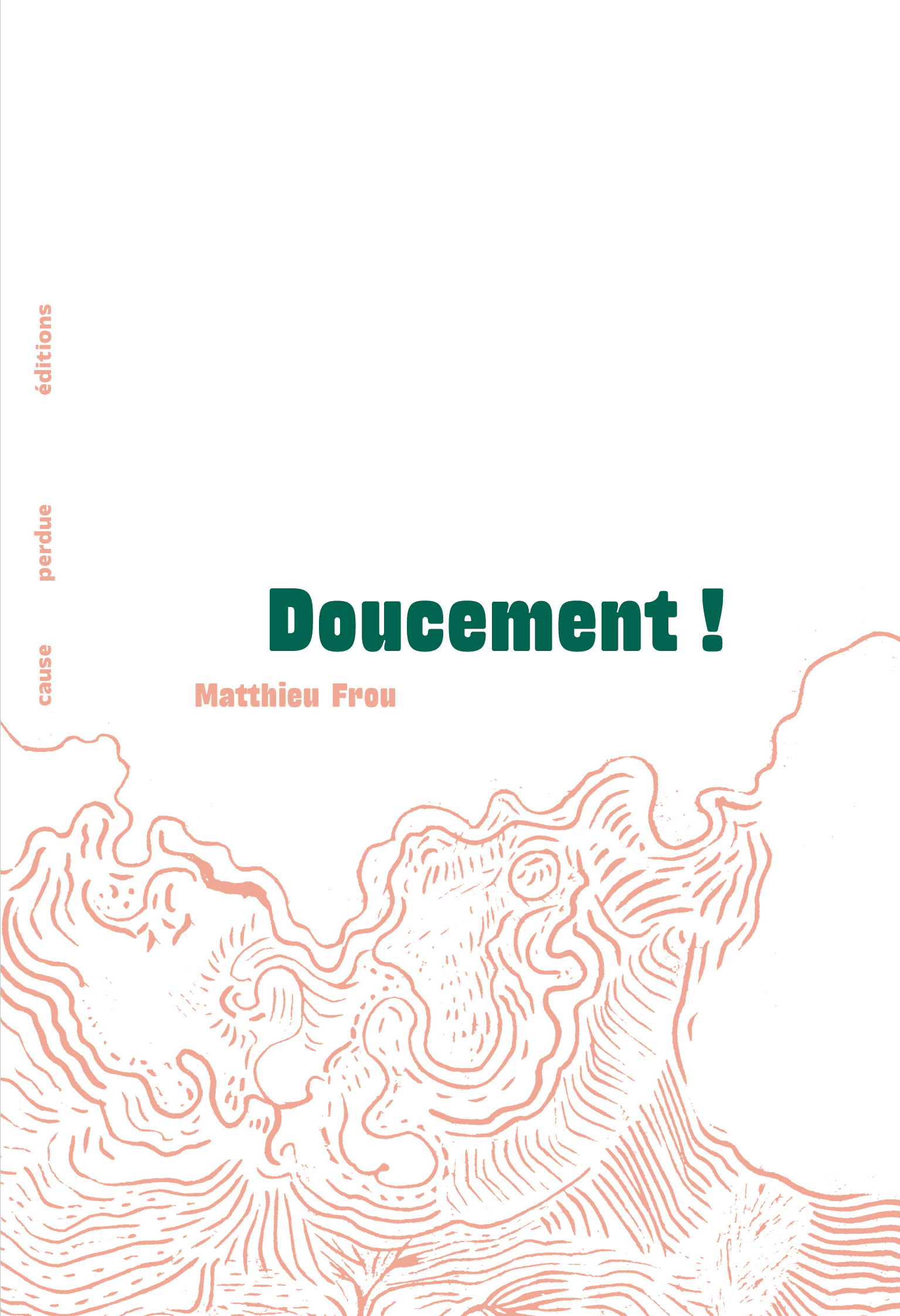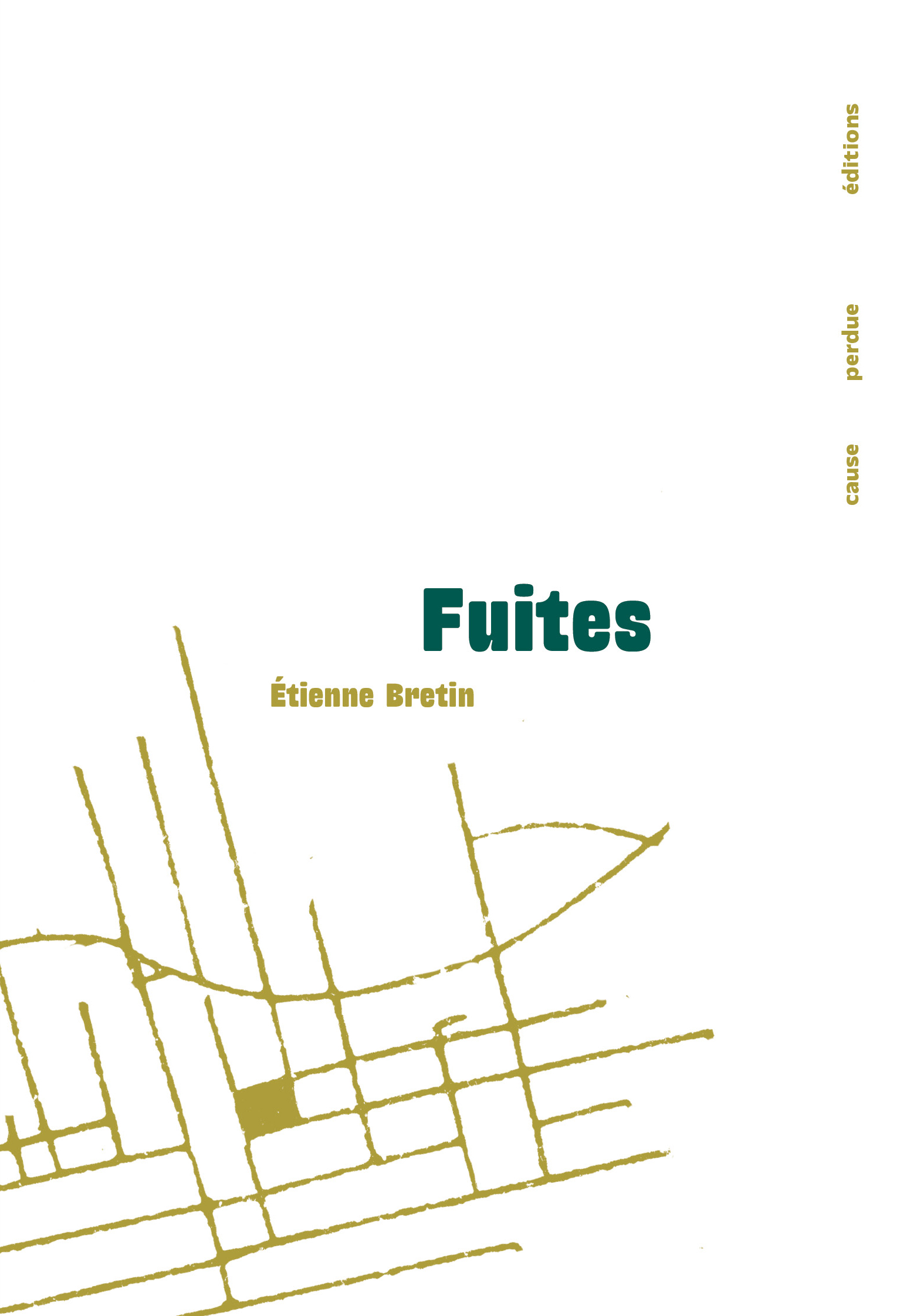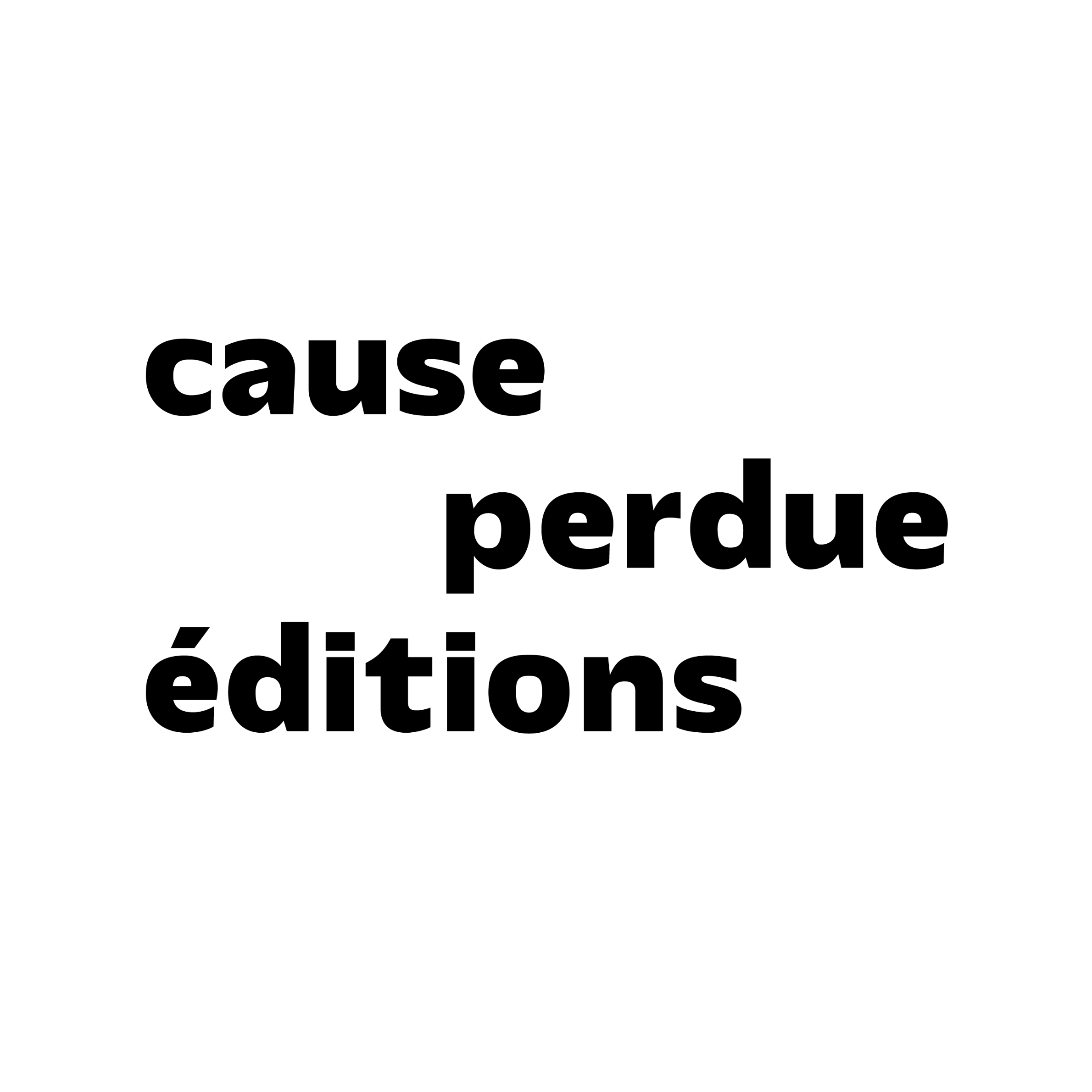Je ne suis pas une libellule, Gwenaël David.
Parution : 20 août 2025. 80 pages.
Le narrateur, naturaliste passionné de libellules, arpente milieux et habitats depuis vingt ans. Au gré de ses visites, il observe ces formidables insectes pourtant si mal connus, collecte leurs exuvies, renseigne, informe, sensibilise, défend et claque une grande partie de sa vie dans les vases et les boues. Ces circulations en zones humides, ces fréquentations animales et végétales, ces rencontres, ces plaisirs et ces dépits, ces situations, ces usages et ces confrontations disent aussi de la marche du monde. Dans le récit d’une quinzaine de prospections de terrain, circulation dans la matière même de ces vivants, s’immiscent des fragments de l’auteur, des doutes, des craintes, des désirs assouvis et de la rage rentrée. Pas après pas dans l’humide s’érige un relief plus ample que le paysage. Se tisse alors une matière plus opaque que le discours, qui raconte la nécessité de se regarder dans la déroute pour en revenir au corps et à l’autre, au sensible et à la joie comme réponse au morbide de la destruction, comme danse à la farce du pouvoir.
La vie d’Abdèle, Izza Amar
Parution : avril 2025. 152 pages.
D’un côté Abdele, de l’autre Adèle. Un chapitre narré par l’une, un chapitre narré par l’autre. Nées dans les années 80, Abdele et Adèle sont sœurs, kabyles et oranaises, ont grandi pendant la guerre civile algérienne et le printemps noir berbère. Elles ont pour seul parent leur mère socialiste laïque tournée musulmane fervente, mais tout les oppose. Abdele est la petite sœur insoumise, bagarreuse, garçonne, footeuse de récré et fouteuse de merde, géniale, buissonnière, mégalo, prêtresse païenne auto proclamée, aspirante prophétesse. Adèle est la grande sœur raisonnable et raisonnée, déterminée mais discrète.
À dix-huit ans, Abdele s’envole vers Paris où elle circule d’amants en amantes, d’école d’ingénieur en centre d’appels, de French touch en French tech. Cependant qu’Adèle reste en Algérie où elle se marie et devient gynécologue. Une passion de la fuite contre une passion de la norme ?
Au fil des trente ans où nous les suivons, l’opposition apparaît comme n’en étant pas une tant la lumière de la survie éclaire leurs routes, tant se déploie une énergie vitale salvatrice. Celle des jours passés à compter les morts dans le quartier et les journaux et à traduire les paroles de Nirvana. Les deux A sont les deux faces d’une même pièce nommée Abdèle, les deux stratégies complémentaires d’une même émancipation. Les mots des deux narratrices sont crus : ils se vengent de la cruauté des euphémismes. Abdele et Adèle ont connu une guerre que l’on ne nomme pas, une oppression régionale que l’on naturalise, une révolte sans issue. Elles éprouvent et observent, des deux côtés de la mer, une domination masculine qui ordonne et la technologie qui occupe. Leurs vies se cherchent dans les marges de deux sociétés, algérienne et française, qui ne se font pas face mais s’accompagnent dans la terreur, la lassitude, les révoltes et les démissions.
Ici, la vie n’est pas fragile comme une fleur mais comme des bombes. La virilité des deux sœurs veut corriger le monde. L’une par la science, l’autre par le romantisme. Leur féminisme est par-delà les bullshit du Nord et du Sud, les fraternités mensongères et les intersections en chantier. Leur féminisme est à hauteur de ces femmes que rien n’effraie, surtout pas l’intimité.
Toledo, 6:55 a.m, Bénédicte Thiébaut
Parution : avril 2025. 160 pages.
Entre le National Museum of Art où il est gardien et l’usine Chrysler où travaille Léna, Markus ne voit pas de différence fondamentale. Depuis son quotidien rythmé par le travail et les trajets en bus, tenaillé par un sentiment d’incomplétude, il observe les gens qui l’entourent et les laisse parfois conduire le récit. Mais alors qu’il effectue sa première garde de nuit, Léna disparaît. L’enchaînement des jours se dérègle, comme en écho aux dérèglements du monde qui voient mourir les poissons, tomber les oiseaux, se déchaîner les éléments. Il lui faut alors partir, pour tenter de demeurer vivant. Des Grands Lacs à la Stone Mountain, des usines automobiles au siège de Coca-Cola, des hivers neigeux de l’Ohio au soleil écrasant de Georgie, Markus trace une diagonale qui transforme des espaces mythiques en lieux familiers.
Toledo, 6:55 a.m. diffuse la lumière tendre des vies qui ne demandent qu’à durer et à faire le moins de mal possible. Son personnage principal ressasse un vide, que la multiplicité des rencontres et des voix du récit, fussent-elles celles de l’eau ou de la roche, participe à combler. L’Amérique du début des 2000, qui résonne des troubles et des crises à venir, annonce les replis, les disparitions, les douleurs et les dégoûts de celle d’aujourd’hui, mais offre aussi de longues lignes de fuites, comme possibilités de l’amour. Le texte ne s’oppose pas mais se pose au côté du mouvement de libération, en courant de ressac, esquivant le viril de la confrontation, l’agitation rhétorique et la surbrillance des discours au profit d’une littérature qui déleste plus qu’elle ne charge.
Dans ce pays où tout peut toujours recommencer, il assume la fuite comme puissance vitale, proposant une forme de politique de la douceur par gros temps. Le roman assume aussi d’être français américain, ou américain français, on ne sait plus où tracer les frontières entre réel et littérature, entre ici et ailleurs, on sait seulement qu’il est possible de se sentir là-bas comme chez soi.
Bien vouloir patienter, Thomas Mairé.
Parution : 13 novembre 2025.
Jonathan parvient à décrocher une formation pour un poste dans un centre d’appel. Entre le Nouveau Tourcoing délabré et un stage express à Amiens, on entre avec lui dans l’openspace de Webophonia, ce « projet innovant » qui nous invite à « Viser le Waouh ». On y croisera des managers médiocres, deux Roms amateurs de pétanque et une petite bande de potentiels salariés loin d’être dupes de l’« aventure ».
Ces figures des jeunesses populaires déclassées nous racontent un prolétariat moderne et les nouvelles formes d’exploitation d’un monde professionnel que nous pensions connaître mais qui nous étonnera toujours.
Doucement ! , Matthieu Frou.
Parution : 14 janvier 2026.
Le narrateur, un jeune homme nommé Thomas, se rend dans un pays d’Afrique, probablement dans un contexte humanitaire. Il est accueilli à l’aéroport par Raoul, fondateur d’une association de prévention contre le SIDA, qui le conduit dans son village et sa famille. Il y rencontre sa femme Leslie, Victoire le bébé, Diane, la sœur de Leslie et Ignace, vague demi-frère de Raoul, sale gosse et souffre-douleur du village dominé par la figure de PAPA. Procédant par succession de scènes fragmentées, le récit met en miroir le présent et les souvenirs de Thomas, fasciné par la violence dont est victime Ignace tandis qu’il observe la sienne remonter à la surface.
Doucement ! explore les manifestations de la brutalité humaine avec une distance lucide et candide à la fois, sans condamner ni absoudre ses personnages, sans s’excepter lui-même de l’examen. Le voyage en Afrique offre au narrateur, à la fois témoin, victime et cogneur, l’occasion de se placer en position d’étrangeté et d’expérimentation, pour chercher à comprendre la violence dans toutes ses dimensions – émotionnelle, sensorielle, sociale.
À travers le personnage de Thomas et son regard sur les faits observés et vécus, le texte questionne notre relation à une violence familiale souvent cachée, refoulée, taboue. Il ouvre ainsi un espace de réflexion sur les mécanismes qui traversent l’individu et la société, et sur la manière dont la littérature peut explorer ces zones d’ombre, là où les discours moraux et sociaux échouent souvent.
Fuites, Étienne Bretin.
Parution : 11 mars 2026.
Le narrateur, trentenaire résidant à Lyon, partage son temps entre son récent emploi de déménageur, les réunions d’une cellule de militants écologistes et les actions collectives de dégonflages de pneus de SUV. La première expédition nocturne, qui ouvre le roman et renseigne sur le déroulé technique d’une telle opération, remporte un succès médiatique : tout Lyon en parle. Une seconde, plus ambitieuse, s’organise pour surfer sur le buzz mais l’action prend une tournure délicate. Responsables et conscients de ce qu’ils provoquent, hostilité générale et récupération politicienne contre la mairie écologiste, le narrateur et trois autres activistes envisagent alors de déployer un gigantesque drapeau anti SUV sur une grue du chantier de construction d’une tour de 43 étages, en plein cœur de Lyon.
Ce premier roman évoque Lyon sous une touffeur permanente, de rue en rue, de parapets en grilles, le long du Rhône ou des couloirs de stationnement. Cette découverte physique de la ville, à fleur d’asphalte et au gré des déambulations des personnages, s’accole à la cartographie émotionnelle et psychologique du narrateur et d’une partie de sa génération.
Doutes, contradictions, peurs et adrénaline illuminent ce roman éminemment politique : le monde du travail, l’amitié et le collectif, l’évolution climatique, la quête de sens commun et l’incurie des luttes politiciennes se tressent ici crescendo, jusqu’à la séquence finale, action de haute volée aussi héroïque que dérisoire.
Du mépris, François Bégaudeau
Parution : printemps 2026.
Le mépris est à la mode. La dénonciation du mépris. Le soupçon de mépris. L’accusation de. C’est sans doute une bonne chose, sans doute un progrès. Personne n’aime être méprisé. Nul n’est fondé à mépriser, nul ne mérite de l’être. Mais qu’en est-il quand la traque du mépris se généralise ?
Qu’en est-il quand chacun se met à voir du « mépris de classe » en tout, y compris les individus des classes supérieures ? Il y a un hic, il y a un loup. Cet essai subjectif, narratif, autobiographique, voudrait traquer ce loup.
Diffusion - Distribution